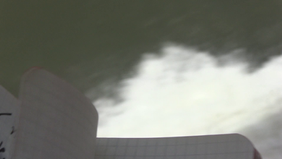top of page

Site en construction, mais déjà visitable !
GUÉ-SAVOIR
Projet doctoral en recherche et création littéraire
Aix-Marseille Université
2020-2026
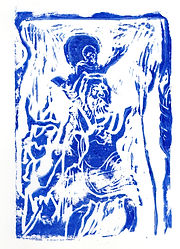
Le Gué-savoir repose sur un jeu de mots : il fait écho à l’expression des troubadours le gai saber, qui désigne à la fois le savoir-faire poétique et la joie créatrice qu’il procure. Ici, le terme gai est remplacé par gué, désignant un passage permettant de traverser un cours d’eau à pied.
Les notes filmiques
La forme du carnet m’a paru une évidence dès les premiers jours du Gué-savoir. Sans que je le sache, ce carnet est devenu bicéphale, afin que le voyage jusqu’au terrain des langues et celui de la poésie se concrétise. Les deux têtes chantent pourtant différemment. D’un côté, des carnets écrits ; de l’autre, des notes filmées. Les deux se questionnent : Comment capturer, comment garder ce qui est toujours filant, incandescent, un état brouillon, et donc souvent aveugle et criard, mais constituant la seule base possible d’une forme artistique en devenir ?
Ces notes filmiques sont les preuves glanées, puis choisies, d’une posture, bien que initiale, d’un corps à la recherche d’une nouvelle langue. Point d’une langue déjà prête, point d’une langue de norme, mais un code fugace d’une expression future. Ce sont des poèmes oraux dans l’espace public, des poèmes improvisés :
« Chanteur, exécutant, compositeur et poète ne font qu’un, sous différents aspects mais au même moment. Le chant, l’exécution, la composition sont les facettes d’un même acte. » (cité d’après Dominique Casajus, L’Aède et le troubadour, 2012, p.11)
Au fil d’une vingtaine de vidéos, plus ou moins expérimentales, on accompagne souvent mon corps, devenu le corps de Jacques Clairsens dans la version écrite Journal de voyage. Ce qui paraît mon corps sert à mettre en scène ce que le journal de voyage désigne par « Bouco ». Ce mot provençal n’est que le cognant du mot français bouche, ou du portugais boca, issus du latin bucca. Silencieuses, mes pages écrites ont réclamé du mouvement afin de pouvoir surgir et se taire dans la lecture faite par autrui. L’idée d’un Bouco écrit est apparue grâce au mouvement du Bouco agité, d’une bouche chantante qui boite, qui marche maladroitement et qui occupe l’espace de manières diverses. Debout, allongé, près de la caméra comme s’il allait la dévorer, ou même coupé du cadre, voire absent, le Bouco est intarissable. Parler c’est tenir la respiration. Il fait du tapage, il est indigné, nerveux, fiévreu, amoureux. Il est surtout surpris par les langues romanes qu’il découvre, par les poésies qu’il rencontre. Le Bouco est le rappel que les premiers temps de la poésie, comme c’est le cas pour la lyrique médiévale des troubadours, furent oraux. Le Bouco est un rappel d’une oralité, quelquefois sacrifiée au détriment du travail écrit. Les notes permettent de donner voix au Bouco, qui n’est que matière à lire dans le Journal de voyage. Tous les lieux que j’ai parcourus durant les voyages du Gué-savoir y sont presque représentés : de Marseille, point de départ, aux vagues du Hudson lors de la visite du Pergaminho Vindel à New York. Les notes attestent le néant, le res troubadouresque d’une langue exposée, dite à voix haute. Le corps, ici, aimerait bien ne plus savoir s’arrêter de gigoter les mots.

bottom of page